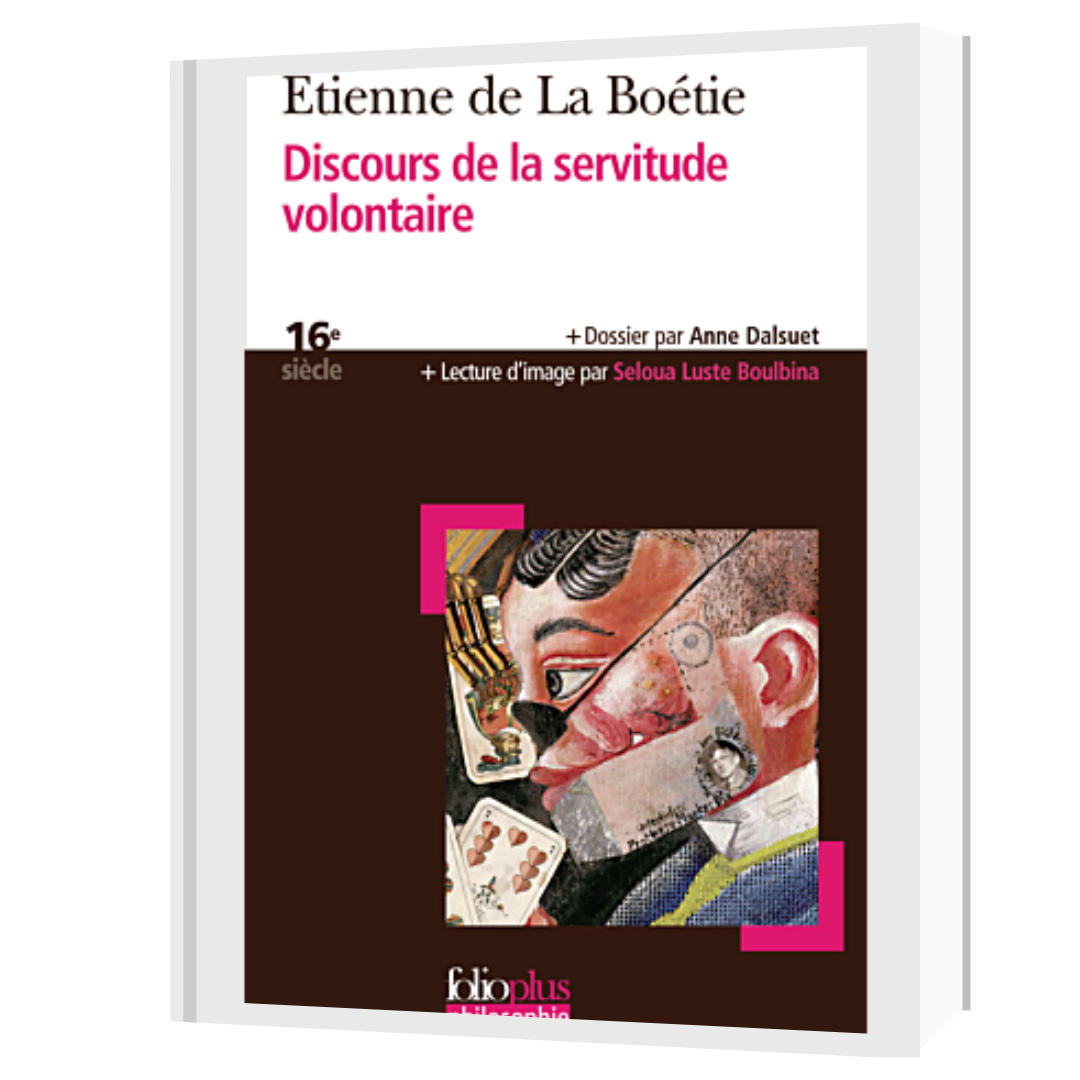Étienne de La Boétie : anatomie de la tyrannie
Quand les peuples choisissent leurs chaînes.
Bonjour à tous,
Je reviens dans cette édition sur un incontournable de la philosophie politique : le Discours de la servitude volontaire d’Étienne de La Boétie.
Il a l’idée de ce texte après la répression sanglante des révoltes paysannes de 1548 consécutives à la création de nouveaux impôts (comme la gabelle, la taxe sur le sel).
Marqué par cet épisode,…
Continuez votre lecture avec un essai gratuit de 7 jours
Abonnez-vous à Morale de l’Histoire pour continuer à lire ce post et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.