Pourquoi et comment revenir à la démocratie directe
Ce que je retiens de la lecture de Faire de la France une démocratie
Bonjour à tous,
Cette newsletter va une nouvelle fois parler de démocratie.
Plutôt que d’analyser son passé, je vous propose d’imaginer son futur (proche ?) grâce au dernier essai de Raphaël Doan , “Faire de la France une démocratie”, édité par Passés/Composés.
J’ai eu l’occasion de recevoir Raphaël Doan il y a un an pour parler des origines antiques du populisme. J’étais très curieux de le lire à nouveau.
Cet essai est à la fois court (110 pages), très concret, astucieux et convaincant. Je devais donc vous en parler.
Alexandre
✨ Et nous accueillons Alexandra, Jérémy, Jocelyne, Pierre et Philippe et tous les nouveaux abonné(e)s depuis la dernière édition. Soyez les bienvenu(e)s ! Vous êtes désormais plus de 1200 à recevoir Morale de l’Histoire dans votre boîte mail.
Dire que la France doit devenir une démocratie revient à affirmer qu'elle ne l'est pas encore. Cette assertion, qui pourrait paraître provocante, relève simplement du constat pour Raphaël Doan, spécialiste de l’Antiquité.
Contrairement à la démocratie athénienne, les lois ne sont pas votées par le peuple mais par ses représentants, c’est à dire une fraction infime de la population. Montesquieu l'observait déjà : "Cela s'appelle une aristocratie".
Dans la même veine, on se rappelle de Rousseau pour qui "la souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n'y a point de milieu"1.
Longtemps, nous vivions dans la “non-démocratie” avec un certain bonheur sans avoir l’impression d’être opprimés. Cela ne posait au fond pas de problème.
Notre régime mélange aristocratie, monarchie et démocratie. Rien que du très classique. Ce n'est donc pas "si grave"2, nous rassure l'auteur :
"[Les anciens] convenaient ainsi que les meilleurs régimes sont ceux qui prennent un peu à l'aristocratie, un peu à la monarchie, un peu à la démocratie."3
Si ce régime hybride a prouvé son efficacité et sa pertinence depuis plus de 200 ans, d'où vient la 'crise' démocratique que nous vivons ? Pourquoi avons-nous l’impression d’institutions immobiles, comme prises dans la glace, incapable de trouver des réponses aux problèmes du pays ? Comment mettre un frein à l’immobilisme ? 4
Et si la solution se trouvait dans un outil aujourd'hui dédaigné par les politiques, mais pourtant bien présent dans notre arsenal constitutionnel ?
L’art perdu du référendum
Le référendum incarne la forme la plus connue de démocratie directe. L'auteur nous ramène aux sources : c'est le principe fondamental du fonctionnement démocratique. Ainsi, les citoyens athéniens votaient eux-mêmes leurs lois sans intermédiaire.
Avec 45 millions d'électeurs, les contraintes pratiques semblent évidentes. Ce qui fonctionnait pour une cité devient impossible pour un pays. Cette évidence est-elle toujours d’actualité en 2025 ?
Si vous lisez ces lignes, c’est que le contenu vous plaît. Alors abonnez-vous gratuitement à cette newsletter afin de ne rater aucune édition.
Internet, les smartphones et leurs applications ont changé la donne depuis trente ans. La démocratie directe redevient techniquement possible quelque soit la taille du corps électoral.
Pourtant, c'est l'inverse qui se produit.
Depuis 1958, l'auteur dénombre seulement dix référendums nationaux, dont cinq organisés par de Gaulle aux premiers temps de la V ème République.
Dans le même temps, la montée du Rassemblement National et de la logique de “front républicain” a conduit les élections présidentielles et désormais législatives à une logique de vote contre et à d’improbable coalitions de fait, aboutissant à un Parlement paralysé en trois blocs dont aucun ne peut réunir de majorité solide. […] La mécanique des institutions est grippée.5
Les causes du blocage
Il y en a plusieurs selon Raphaël Doan : la marginalisation d'un parti qui rassemble 30 à 40% des voix sans possibilité d'alliance ; le clientélisme qui privilégie les intérêts particuliers sur l'intérêt général et entrave les majorités d'idées pourtant présentes dans la population.
Alors la démocratie participative peut-elle, à défaut de référendums, offrir une alternative ?
La démocratie participative est ainsi devenu le hochet privilégié d’une classe politique qui refuse la démocratie directe. C’est pire qu’un compromis : c’est une façon d’éviter la véritable participation du peuple tout en prétendant la favoriser. La seule participation qui vaille est celle qui donne un réel pouvoir de décision. Tout le reste - débats, assises, concertations, conventions - n’est que de la poudre aux yeux.6
Le constat est sévère mais l’histoire récente conforte ce point de vue. Le livre pointe (à raison selon moi) un autre problème : la médiocrité de la classe politique.
Chaque débat est survolé, réduit à quelques slogans idiots, et donne le sentiment d’une dichotomie dramatique entre le fond des réformes, jugé trop technique pour être compréhensible, et le débat médiatique, trop superficiel pour être pédagogique.
Injecter de la démocratie directe dans notre régime, c’est donner une chance au débat de se recentrer sur les véritables enjeux, de manière claire et compréhensible.7
Car c’est l’intérêt majeur du référendum : il peut révéler les majorités d'idées chez des Français moins divisés qu'il n'y paraît. Sur bien des sujets, les français s’accordent sur la meilleure option. L'Assemblée Nationale, scindée en trois blocs, donne l'illusion d'oppositions insurmontables. Le référendum devient, pour utiliser une image footballistique, un "lob" institutionnel, une façon de contourner les obstacles par le haut.
Selon Raphaël Doan, c’est cette pratique qui préserve la Suisse des dérives populistes. Même constat pour Taïwan ou certains États américains.
Une évolution et non une révolution
Alors, faut-il revoir la Constitution de fond en comble ? L’auteur nous promet-il de la sueur, du sang et des larmes ? Comment banaliser l’usage du référendum ?
L’essayiste a trouvé un chemin plus simple qui libère l'usage du référendum avec un effort minimal. Une évolution de l'article 11 suffirait à élargir son cadre d'usage et faciliter son activation. Par exemple, il imagine redonner l’initiative d’un référendum aux députés. Un quart d’entre eux seraient en mesure d’en déclencher un une fois par an.
L’auteur va plus loin et anticipe les objections. Par exemple, celle bien connue selon laquelle les votants répondent non pas à la question posée, mais en fonction de qui la pose. Autrement dit, si je soutiens le pouvoir en place, je vote pour, sinon je vote contre, quel que soit l’objet du référendum.
Raphaël Doan propose, pour éviter cela, de jouer sur la temporalité des élections et des référendums afin que les votants répondent vraiment à la question posée.
Au fond, les outils de la démocratie ne s’usent que si on ne les utilise pas. Aux politiques désormais de s’emparer de ces idées concrètes pour faire fondre la glace qui retient le souffle démocratique. Auront-ils le courage de s'aventurer dans l'inconnu d'une démocratie plus directe peut-être plus inconfortable pour eux que le statu quo ?
Le courage, cette qualité qui garantit toutes les autres.8
Si vous identifiez des erreurs, merci de m'informer par e-mail en répondant à ce message.
Alexandre
Du contrat social, Livre III, chapitre XV
Ibid., p11
Celle-ci est de Raymond Barre.
Ibid., p42
Ibid., p44
Citation de Winston Churchill : « Le courage est la première des qualités humaines car c'est celle qui garantit toutes les autres. »


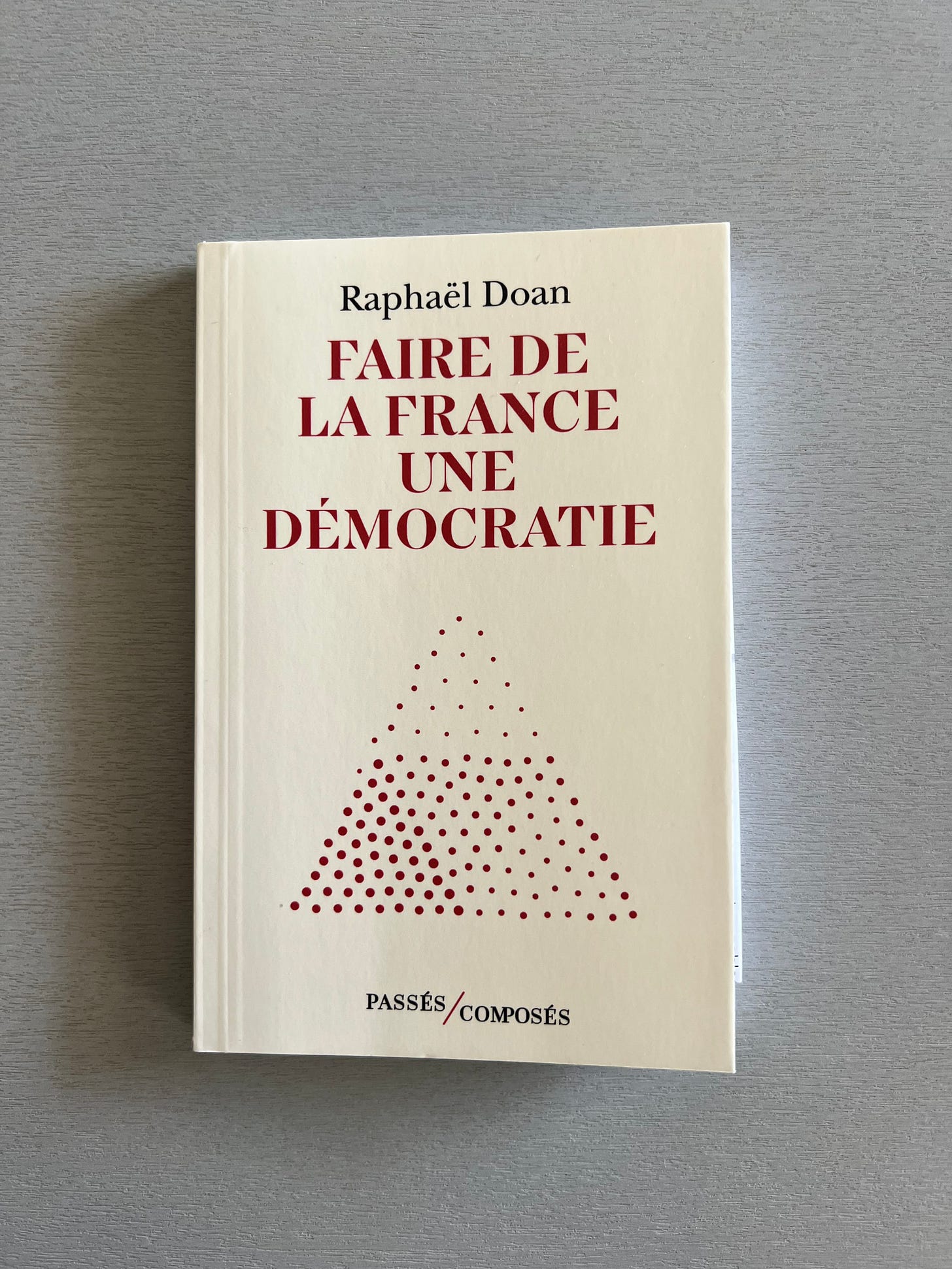

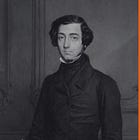
Mouai, ça semble un peu facile de rejeter la démocratie participative pour encenser le référendum juste après, et il aurait été judicieux que de rappeler que ce dernier est une réponse à une question posée et non un choix que font les citoyens. Dois-je rappeler ce qu'il s'est produit avec le dernier référendum que nous avons connu ?
Jouons le jeu malgré tout, admettons que le référendum soit étendu, ce qui serait une bonne chose, admettons aussi que le référendum se transforme en véritable choix démocratique, et non plus une simple question. Dans le cas-là, ç'aurait été mieux d'étendre la réponse de l'auteur, expliquer pourquoi il juge la démocratie participative comme tel :
“La démocratie participative est ainsi devenu le hochet privilégié d’une classe politique qui refuse la démocratie directe. C’est pire qu’un compromis : c’est une façon d’éviter la véritable participation du peuple tout en prétendant la favoriser. La seule participation qui vaille est celle qui donne un réel pouvoir de décision. Tout le reste - débats, assises, concertations, conventions - n’est que de la poudre aux yeux.”
J'ai l'impression qu'il a voulu écrire un beau paragraphe… mais c'est tout. En quoi la démocratie participative et le référendum ne pourraient-ils pas être complémentaires ? Il semble défendre son bout de gras en somme, ce que convenaient les anciens comme étant le meilleur régime (“les meilleurs régimes sont ceux qui prennent un peu à l'aristocratie, un peu à la monarchie, un peu à la démocratie”), mais ce n'est pas défendre la démocratie ça. C'est, à la rigueur, pointer du doigt le manque de démocratie en France, mais c'est tout… et malheureusement un peu limité.
🗳️ Merci Alexandre pour ce résumé clair et stimulant de l’essai de Raphaël Doan !
Tu m’as donné envie de relire Rousseau et d’actualiser ma carte électorale. Un miracle !